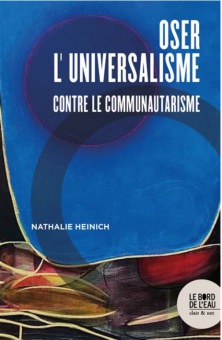La crise mondiale est pour demain
Pour l'ancien Premier ministre, tous les facteurs d'une crise économique d'une ampleur considérable sont réunis. Comment en est-on arrivé là ? Que peut-on faire ? Par Michel Rocard 2008
Le Nouvel Observateur.- Avec les excès de la «financiarisation» de l'économie, on entend souvent dire que nous sommes à la veille d'une crise mondiale de
l'ampleur de celle de 1929. Qu'en pensez- vous ?
Michel Rocard. - Nous
sommes dans une situation étrange : les signes avant-coureurs d'une crise mettant en cause l'équilibre général de l'économie s'amoncellent et pourtant les «opérateurs» restent silencieux. Ils
ne disent rien alors que pour la première fois, depuis deux cents ans, le capitalisme est combattu non par ses vaincus, ses pauvres ou par les intellectuels, porte-parole des vaincus, comme Marx ou
Engels, mais par des économistes objectifs. Aujourd'hui, la critique vient du coeur du système. L'avant-dernier livre de Patrick Artus, un des économistes français les plus respectés, était
intitulé : «Le capitalisme est en train de s'autodétruire». Son dernier livre porte un titre prémonitoire : «les Incendiaires». Les «incendiaires» en question sont les banquiers centraux. Il doit
vraiment y avoir quelque chose de pourri dans notre système pour que Joseph Stiglitz, prix Nobel américain d'économie, ose, lui, titrer son dernier un ouvrage «Quand le capitalisme perd la
tête».
N. O. - Qu'est-ce qui vous rend si pessimiste ?
M. Rocard. - Pour illustrer mes propos, je partirai de l'évolution de la dette des Etats-Unis (dette des ménages, des entreprises et de l'Etat) sur une longue
période. On voit clairement son envolée depuis 1982 (présidence Reagan) jusqu'à 2005 (présidence George Bush), en dépit d'une certaine stabilisation sous Clinton. Lors de la crise de 1929,
l'endettement américain - environ 130% du produit national - était déjà «au coeur du système». Aujourd'hui il atteint plus de 230% ! Pour éviter la faillite, le système financier américain
doit emprunter 2 milliards de dollars par jour ! Voilà ma première inquiétude. Vous me direz - et c'est la deuxième bizarrerie de notre situation - que le système financier s'est «atomisé» : si
les grandes banques mondiales par qui le scandale arrive sont quatre fois plus grosses qu'en 1929, elles opèrent dans un marché 50 à 100 fois plus gros puisque les transactions quotidiennes se
comptent en dizaines de milliards de dollars. Cette dilution, cette atomisation a amorti les crises qui ont réapparu depuis 1990.
Il faut rappeler que de 1945 à 1980 le monde n'a connu que des faillites nationales, pas de crises mondiales. C'était un des grands succès du capitalisme régulé. Le problème - et revoilà mes inquiétudes -, c'est que depuis 1980 la sphère financière a pris une importance colossale. Du coup, nous sommes confrontés à des crises financières de grande ampleur récurrentes : crises latino- américaines dans les années 1980 qui ont affecté tout le continent américain; crise asiatique dans les années 1990 qui a fait des dégâts énormes même si elle est restée circonscrite à une douzaine de pays, crise du système monétaire européen en 1992, éclatement de la bulle de l'e-économie en 2000. Les centaines de milliards de dollars carbonisés par l'effondrement des valeurs boursières à l'occasion de cette dernière secousse sont comparables aux pertes enregistrées lors de la crise de 1929. Les chocs sont moins instantanés, moins brutaux, moins impressionnants peut-être aussi, mais ils sont quand même terrifiants, même si l'atomisation des marchés les a rendus moins soudainement brutaux.
Regardons maintenant les choses de plus près en commençant par la dette. La dette américaine hors banques vient d'atteindre 39 000 milliards de dollars. Il est évident qu'elle ne sera jamais remboursée. Nous sommes dans une logique qui ne laisse espérer aucun retournement de tendance. Le problème est donc celui de la «soutenabilité» de cette dette grossie chaque jour de ses intérêts composés. Jusqu'ici, des taux d'intérêt historiquement bas permettaient d'emprunter et de l'honorer. Avec la hausse du prix du pétrole qui hésite cette semaine à passer la barre des 100 dollars le baril et l'envolée des prix des produits agricoles, dopés par l'augmentation de la demande alimentaire de l'Inde et de la Chine, cette possibilité est en train de disparaître. Je m'explique : pourcontrer le retour de l'inflation, les banques centrales sont obligées de relever leur taux d'intérêt. C'est le devoir de Jean-Claude Trichet, président de la Banque centrale européenne, et certaines institutions comme la Banque d'Angleterre n'hésitent pas à augmenter franchement leur prix de l'argent. L'atomisation du marché nous a jusqu'ici préservés d'une crise générale, mais les miracles n'ont qu'un temps.
N. O. - Comment en est-on arrivé à cette dette colossale alors qu'il y a tant d'argent
disponible ?
M. Rocard. - Ce passage
d'un équilibre à un déséquilibre massif, généralisé, tient au changement de la répartition du produit national brut, entre les «salaires» (salaires et revenus de protection versés par la
Sécurité sociale) et les «profits» (bénéfices industriels, honoraires des professions libérales, rémunérations «directes» sur le marché). Ce mouvement est très sensible en France mais on
l'observe aussi aux Etats-Unis et dans l'ensemble des pays européens, y compris les pays de l'Est rejoints à toute allure par le capitalisme. En gros, les salaires sont passés de 71% du PIB en
1981 à 60% en 2005. Près de 11 points de chute ! Aujourd'hui, en France, si le produit intérieur brut avait conservé le même partage qu'en 1981, les ménages auraient dépensé en salaires et
revenus de Sécurité sociale 130 milliards d'euros de plus. Affectés à la consommation, ces 130 milliards auraient donné au moins 1 point de plus de croissance chaque année. Et nous aurions eu
en France un demi-million de chômeurs de moins.
N. O. - Que s'est-il passé ? Comment s'explique ce nouveau «partage» entre salaires et
profits ?
M. Rocard. - Pour
comprendre la perversité de ce nouveau partage qui ne permet plus à la consommation de soutenir la croissance et, à terme, de créer les moyens de rembourser la dette, il faut se rappeler comment
a fonctionné le capitalisme triomphant de 1945 à 1975. Pendant trente ans, l'économie occidentale a progressé au rythme de 5% l'an, sans jamais de crises financières et avec un chômage quasi
nul (2% de la population active, c'est à peu près le chômage frictionnel dû à la mobilité professionnelle) . Les raisons de cette embellie ? Précisément les mauvais souvenirs de la grande
crise de 1929, de son cortège de malheurs avec la prolétarisation des classes moyennes et finalement la guerre. Pour que pareille catastrophe ne se reproduise pas, le monde occidental avait mis en
place trois types de correction dont chacune a pour père une personnalité exceptionnelle : lord Beveridge, lord Maynard Keynes et Henry Ford. Beveridge, c'est l'Anglais inventeur de la Sécurité
sociale, qui a théorisé le fait qu'en faisant beaucoup de protection sociale non seulement on humanisait le système, mais on le stabilisait en empêchant la demande - maintenue au moins au tiers
du pouvoir d'achat - de tomber. Deuxième régulateur, Keynes. Message aux dirigeants politiques : au lieu d'utiliser la politique monétaire et budgétaire comme des instruments de régulation
nationale, utilisez-la pour accélérer ou décélérer les secousses venant de l'extérieur, du marché mondial, là où les pays démocratiques s'affrontent. Cela a marché. Nous en avons eu la
preuve expérimentale pendant trente ans. Le troisième régulateur, Henry Ford, est américain. Cet industriel disait : «Je paie mes ouvriers pour qu'ils m'achètent mes voitures.» Avec le New Deal, les grands travaux de Roosevelt, cette politique de hauts salaires et de fidélisation des salariés qualifiés a permis à l'économie américaine
de repartir très vite après la crise de 1929. La France a utilisé le Plan, ce forum entre syndicats, patrons et Etat, réunis pour préserver un haut niveau de demande (donc de salaires)
afin de permettre des anticipations de consommation forte. Bref, nous nous sommes tous peu ou prou lancés dans des politiques de reconnaissance du monde salarial et de légitimation d'une politique
de hautes rémunérations parce que, concernant la moitié basse de la population, ces dernières sont presque entièrement affectées à la consommation. Et fondent la croissance.
Résultat : une croissance soutenue, mais avec un grand absent, l'actionnaire - une des composantes du «profit», selon la
comptabilité nationale. Il a été le grand oublié en termes de distribution de dividendes pendant toute cette
période.
Tout a changé dans les années 1990 avec l'apparition des fonds et d'abord des fonds de pension. L'actionnaire s'est organisé et, s'agissant de sa retraite, a exigé un retour sur investissement de plus en plus élevé. Corollaire : une pression de plus en plus forte sur les salaires qui ont cessé de progresser au rythme d'antan avant de décroître en valeur absolue. Les fonds d'investissement - moins du quart des fonds de pension mais plus agressifs - ont intensifié la tendance. Et les fonds d'arbitrage ou hedge funds jouent le même jeu. Pour garantir aux actionnaires une rémunération élevée, tous n'hésitent pas à démanteler leur proie et à vendre par appartements. Au grand dam des salariés réduits à la dimension de variable d'ajustement. Le nouveau système - avec les hedge funds, ces fonds spéculatifs. L'ensemble de ces fonds sont présents désormais dans toutes les entreprises du monde occidental de plus de 2 000 salariés. Leur pression s'est d'abord exercée sur les PDG qui ne distribuaient pas assez de dividendes : ils ont très vite valsé. Elle s'est traduite ensuite par l'externalisation des toutes les fonctions - entretien, maintenance, services sociaux internes -, dont les salariés étaient indexés sur les personnels qualifiés qui faisaient le renom de l'entreprise. Tous ces gens-là ont été chassés et recasés dans des PME désyndicalisées, soumises à des contraintes salariales énormes parce que les fabricants, les donneurs d'ordre, peuvent changer de sous-traitants sans préavis. C'est comme ça que s'est instituée la précarisation du marché du travail (16% des salariés français aujourd'hui) avec, comme conséquence de cette réduction «contrainte» des heures travaillées, un gel ou un recul des salaires, l'apparition de working poors et de vrais pauvres sans travail. Avec une pauvreté de masse évaluée à 10 millions de personnes en Grande-Bretagne et entre 5 et 6 millions en France, la part des salaires dans le PIB a évidemment reculé par rapport au «profit» réinvesti de manière spéculative.
D'où, faute d'une demande suffisante, une croissance anémiée, incapable de contenir l'hémorragie des déficits et une dette de plus en plus difficile à rembourser.
N. O. - Recherche d'une plus-value instantanée, spéculation effrénée et, comme l'indique la crise des crédits hypothécaires aux Etats-Unis, «titrisation» des créances et création de produits de plus en plus sophistiqués plongeant les marchés dans l'opacité : tous les ingrédients d'une crise d'ampleur sont réunis. Mais la donne aussi a changé : il y a la croissance générée par les pays émergents qui relaie la locomotive américaine défaillante. Il y a aussi l'abondance de liquidités : pétrodollars et excédents structurels chinois ou japonais.
M. Rocard. - Par rapport à l'économie physique réelle, ces liquidités sont en effet sans précédent. Mais elles ne s'orientent pas vers l'investissement long. Elles préfèrent les investissements financiers spéculatifs. Tous les banquiers vous le diront, malgré leur affinement, les politiques économiques ne peuvent rien sur l'usage et l'évolution de ces liquidités. Ce dysfonctionnement, culturel dans sa nature, structurel dans son résultat, est terrible. Personne ne sait comment ça peut finir, et j'ai la conviction que ça va bientôt exploser. J'en tire deux conclusions. La première, c'est qu'il faut des réponses mondiales, en réformant les institutions créées il y a plus d'un demi-siècle à Bretton-Woods. Nouveau directeur du Fonds monétaire international, notre ami Strauss-Kahn est aux commandes d'un «machin» qui n'est pas opérationnel car il n'a pas les moyens de contrer ces nouvelles crises. Mais il a l'information : c'est l'endroit central pour émettre un diagnostic et faire des propositions. Ma deuxième conclusion : si en France le PS était capable de comprendre ce qui se passe, de faire la liaison entre la situation nationale et l'international et pouvait expliquer les raisons de la montée du travail précaire chez nous, il donnerait enfin l'impression de répondre à la situation. Il y aura une prime au premier qui saura expliquer. C'est le capitalisme dans sa forme mondialisée et financiarisée non le marché dont je suis partisan - qui est en cause aujourd'hui. Faire ce type d'analyse, lui donner une réponse nous réconcilierait avec les gauchistes ! Enfin il est essentiel que de nouvelles règles aident à préparer une place commerciale intelligemment négociée à ces nouveaux partenaires énormes que sont la Chine et l'Inde.
N. O. - Que peut-on faire ?
M. Rocard. - Il y a d'abord l'attaque éthique. Au centre de cette pression sur les salaires, de cette voracité spéculative des hautes classes
moyennes et des classes riches, les gens fraudent de plus en plus : délits sur les stock-options, délits d'initié... Il faut maintenir une pénalisation du droit des affaires. De la même
manière, il faut plafonner les revenus des grands patrons. A l'époque de Henry Ford, ils étaient payés 40 fois le salaire moyen, aujourd'hui, c'est 350 ou 400 fois ! (On peut
considérer que ce superprélèvement directorial est négligeable, il est cependant particulièrement inélégant et nocif.) Puisqu'on veut moins d'Etat, le capitalisme doit rester éthique.
Deuxième élément : réglementer les OPA au niveau européen en énonçant des critères qui empêcheront la destruction et la précarisation de la population salariale du groupe
ainsi constitué. Ensuite, il faut que les accords sur le droit social passés dans le cadre de l'Organisation internationale du Travail (OIT) soient compatibles avec les règles de l'Organisation
mondiale du Commerce (OMC) qui fait du libre-échange une religion. Aujourd'hui, les Etats peuvent ignorer superbement ce qu'ils ont signé d'une main à l'OIT quand ils négocient à
l'OMC.
3Je crois enfin à l'économie sociale. J'ai milité depuis quarante ans pour lui donner son statut, son cadre. Je crois que la clé du problème, c'est le changement du statut juridique de l'entreprise. Au lieu d'appartenir à des apporteurs extérieurs de capitaux, elle doit être faite de la communauté des hommes et des femmes qui gagnent leur vie en partageant un même projet économique.
N. O. - Retour à l'autogestion ?
M. Rocard. - Je me
garderais bien d'employer les mots qui fâchent. S'agissant d'un projet mondial, je ne vois qu'une seule force capable de le mener à bien : la social-démocratie internationale. Il va falloir
défendre tout ce qui produit contre tout ce qui spécule. C'est ça, la nouvelle lutte des classes.
Michel Rocard . Derniers ouvrages parus : «Si la gauche savait» (Robert Laffont, 2005) et «Peut-on réformer la France ?» (Autrement, 2006).
Jean-Gabriel Fredet, François Armanet Le Nouvel Observateur